Étude comparative des théories morales religieuses, laïques et humanistes
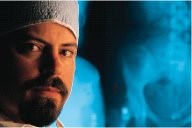 Alors, quelle est la meilleure façon d’évaluer les théories morales? Pour vous faciliter la tâche sachez que les théories morales sont comme les théories scientifiques. Les théories scientifiques tentent d’expliquer les causes des événements, comme une réaction chimique, l’orbite d’une planète, ou la croissance d’une tumeur. Une théorie jugée valide est compatible avec toutes les données pertinentes. Les théories morales à leurs tours essaient d’expliquer en quoi consiste une bonne action ou une bonne personne. Une théorie morale valide doit également être compatible avec toutes les données pertinentes. Sauf qu’ici ce que les théories morales doivent expliquer sont ce que les philosophes appellent nos «jugements moraux réfléchis», c’est-à-dire les jugements moraux que nous acceptons comme valide, après réflexion critique sur eux. Toute théorie morale valant son pesant d’or sera conforme à ces standards. Si elle ne l’est pas, si, par exemple, elle approuve des actes manifestement immoraux, alors la théorie est erronée et doit être rejetée. Si notre théorie morale sanctionne, par exemple, le fait d’infliger des souffrances imméritées et inutiles à des enfants innocents, nous devons alors conclure que quelque chose ne va pas avec notre théorie.
Alors, quelle est la meilleure façon d’évaluer les théories morales? Pour vous faciliter la tâche sachez que les théories morales sont comme les théories scientifiques. Les théories scientifiques tentent d’expliquer les causes des événements, comme une réaction chimique, l’orbite d’une planète, ou la croissance d’une tumeur. Une théorie jugée valide est compatible avec toutes les données pertinentes. Les théories morales à leurs tours essaient d’expliquer en quoi consiste une bonne action ou une bonne personne. Une théorie morale valide doit également être compatible avec toutes les données pertinentes. Sauf qu’ici ce que les théories morales doivent expliquer sont ce que les philosophes appellent nos «jugements moraux réfléchis», c’est-à-dire les jugements moraux que nous acceptons comme valide, après réflexion critique sur eux. Toute théorie morale valant son pesant d’or sera conforme à ces standards. Si elle ne l’est pas, si, par exemple, elle approuve des actes manifestement immoraux, alors la théorie est erronée et doit être rejetée. Si notre théorie morale sanctionne, par exemple, le fait d’infliger des souffrances imméritées et inutiles à des enfants innocents, nous devons alors conclure que quelque chose ne va pas avec notre théorie.
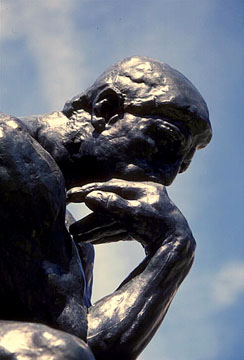 Pour être considérés comme valide, les théories scientifiques doivent également être compatibles avec toutes les informations pertinentes. Une théorie sur l’explosion d’une étoile, par exemple, ne doit pas seulement être cohérente avec les données concernant l’explosion elle-même, mais avec sur ce que nous savons déjà de la gravité, de l’espace, de la chaleur, de la lumière et du résultat des instruments de mesure scientifiques. De même, les théories morales plausibles doivent être cohérentes avec les faits pertinents, c’est-à-dire, notre expérience d’une vie morale. Cela implique donc;
Pour être considérés comme valide, les théories scientifiques doivent également être compatibles avec toutes les informations pertinentes. Une théorie sur l’explosion d’une étoile, par exemple, ne doit pas seulement être cohérente avec les données concernant l’explosion elle-même, mais avec sur ce que nous savons déjà de la gravité, de l’espace, de la chaleur, de la lumière et du résultat des instruments de mesure scientifiques. De même, les théories morales plausibles doivent être cohérentes avec les faits pertinents, c’est-à-dire, notre expérience d’une vie morale. Cela implique donc;
- Porter des jugements moraux
- À l’occasion remettre en question la morale
- Agir parfois de façon immorale
Toute théorie qui suggère que ces expériences fondamentales ne sont pas pertinentes doit être considéré suspecte. Certaines théories morales répandues suggèrent en fait que nous ne faisons jamais l’expérience de telles choses. Le refus de prendre en considération ce qui constitue notre expérience morale commune est un argument de taille contre de telles théories.
Il est logiquement possible de prétendre que notre expérience commune de la vie morale est une illusion, qui nous laisse croire qu’elle implique des jugements moraux, des conflits et des erreurs. Il est possible que les théories qui renoncent à faire appel à notre expérience de la moralité soient correctes et que ceux qui prétendent le contraire aient tout faux. Mais à moins que nous ayons de bonnes raisons de rejeter notre expérience comme n’étant qu’une illusion, nous sommes justifiés de l’accepter à sa valeur nominale.
Une autre façon de présenter la chose est que notre expérience de la vie morale tombe sous le sens. Le bon sens, bien sûr, peut se tromper sur plusieurs sujets, notamment sur la forme de la Terre et les causes des maladies. Mais il ne s’ensuit pas forcément que, parce que le bon sens se trompe parfois, il a toujours tort. L’approche la plus raisonnable est d’accepter le bon sens à moins qu’une alternative lui soit nettement supérieure.
L’utilité d’avoir une théorie morale, c’est qu’elle nous guide lorsque vient le temps de choisir les bonnes actions. Et ce guide devient particulièrement important lorsque nous nous retrouvons face à des dilemmes moraux , des situations où nos principes et nos jugements entrent en conflit. Toute théorie morale qui ne nous ait d’aucune aide face à ces problèmes est dite impraticable et toute théorie inapplicable est une mauvaise théorie.
Donc, toutes les théories morales valides doivent …
- Être cohérent avec nos jugements moraux raisonnés
- Être cohérent avec notre expérience d’une vie morale
- Être applicable
Ces critères nous permettent de procéder à une évaluation équitable de tous les types de théories morales, religieuses, laïques et humanistes.
Cinq théories morales
L’utilitarisme
Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, l’utilitarisme propose qu’une action est juste si elle maximise le bonheur en général, en tenant compte du plus grand nombre. Si une action maximise le bonheur, elle est par le fait même, moralement correcte, indépendamment des motivations des personnes impliquées ou la façon dont le bonheur est atteint. Donc faire le bon choix signifie calculer combien de bonheur peut être produit à partir de plusieurs actions possibles et choisir l’action qui génère la plus grande quantité de bonheur.
Nous avons également vu que l’utilitarisme est en contradiction avec certains de nos jugements moraux raisonnés. Certaines actions ne devraient tous simplement pas être accomplies, même si le but ultime produirait potentiellement plus de bonheur. En d’autres termes, les personnes ont certains droits et ces droits ne doivent pas être violés simplement dans le but de promouvoir le bien commun. Par exemple, peut-on justifier le fait d’accuser faussement, de condamner et punir quelqu’un si cela se traduit par plus de bonheur pour une ville entière? Si le bonheur d’une douzaine de personnes pourrait être augmenté en ne torturant qu’un seul, cela justifie-t-il la torture? En général, nous considérons qu’il est mal de violer les droits et de commettre des injustices même si cela procurerait du bonheur à certains.
Enfin nous avons observé que l’utilitarisme est en contradiction avec notre compréhension des devoirs. On ne peut simplement pas ignorer les devoirs que nous avons envers d’autres personnes, comme le devoir de tenir nos promesses. l’utilitarisme , cependant, dit que notre devoir est de maximiser le bonheur, peu importe si nous devons briser nos promesses pour le faire. Revenir sur sa parole devient alors juste un autre moyen d’arriver à nos fins. Mais notre bon sens nous suggère que de tenir ses promesses est plus important que ce que l’utilitarisme voudrait bien nous faire croire. Une promesse à davantage de poids moral que d’autres types de déclarations que nous pourrions faire, sinon faire une promesse ne voudrait plus rien dire.
D’autre part, l’utilitarisme nous rappelle quelque chose d’important que toute bonne théorie morale doit prendre en compte; les conséquences de nos actions. Il est entendu que nos actions peuvent avoir une signification morale. Les théories absolutistes celles qui se contentent de nous faire suivre des règles en ignorant les conséquences, sont en conflit avec nos jugements moraux raisonnées.
Prenant compte de ce qui précède, certains se sont posés la question, existe-t’il une forme de l’utilitarisme qui répond mieux à notre vie morale et à nos jugements? La réponse est oui, l’utilitarisme de la règle. Cette variété de l’utilitarisme ne se concentre pas uniquement sur combien de bonheur une certaine action peut produire, mais plutôt combien de bonheur une certaine règle peut produire. Selon l’utilitarisme de la règle, les bonnes actions sont celles qui s’accordent avec une règle qui ne souffre pas d’exceptions et qui, si constamment suivie, se traduirait par davantage de bonheur, pour le plus grand nombre. Donc, pour déterminer si une action est bonne, vous devez d’abord vous devez vous poser la question suivante; quelle règle s’applique dans ce cas particulier? Puis vous demander si cette règle produira davantage de bonheur de façon durable. Selon cette théorie donc, la conclusion serait qu’il convient de suivre à la lettre la règle « ne pas voler », même si, dans un cas particulier, ne pas voler peut entraîner moins de bonheur.
l’utilitarisme de la règle peut sembler une amélioration par rapport l’utilitarisme tout court, mais elle aussi entre en conflit avec certains de nos jugements raisonnés. Il est assez facile d’imaginer une règle que, si constamment suivie, permettrait de maximiser le bonheur dans le monde, mais aussi violerait les droits de certaines personnes, causerait une injustice, ou ignorerait certains devoirs. Une société peut, par exemple, concevoir une règle qui permet de tuer, torturer et violer quelqu’un, si cet acte maximiserait le bonheur de plusieurs. Dans certains cas extrêmes, ces règles pourraient sanctionner l’assassinat de masse, le «nettoyage ethnique», et la persécution de toutes sortes de groupe sociaux ou racial. Si la l’utilitarisme de la règle pourrait permettre de telles actions, il y aurait un sérieux problème avec cette approche.
En fait, il semble y avoir un problème avec l’idée que le bonheur soit le but ultime de tout système moral valant son pesant d’or. Les deux grands types d’utilitarisme présupposent que le bonheur est la seule valeur intrinsèque. Mais nous pouvons imaginer des situations dans lesquelles des gens font l’expérience du plus haut degré de bonheur possible, tout en passant à côté de choses importantes qui donnent à la vie toute sa signification.
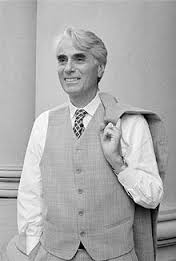 Le philosophe Robert Nozick a illustré ce point en proposant une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes connecté à une machine qui vous donne accès à toutes sortes d’expériences sensorielles. Vous pensez ressentir le bonheur d’écrire un roman, d’avoir pleins d’amis et faire mille autres choses agréables. Mais en fait tout ce que vous faites est de flotter dans une cuve pendant que la machine fait son travail. Vous êtes heureux, paisible, croyant que vous dirigez votre propre vie et que vos choix sont libres en tous temps. Donc, vous restez connecté à cette machine pour le reste de votre existence (cela ne vous rappelle pas le film « La Matrice »?).
Le philosophe Robert Nozick a illustré ce point en proposant une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes connecté à une machine qui vous donne accès à toutes sortes d’expériences sensorielles. Vous pensez ressentir le bonheur d’écrire un roman, d’avoir pleins d’amis et faire mille autres choses agréables. Mais en fait tout ce que vous faites est de flotter dans une cuve pendant que la machine fait son travail. Vous êtes heureux, paisible, croyant que vous dirigez votre propre vie et que vos choix sont libres en tous temps. Donc, vous restez connecté à cette machine pour le reste de votre existence (cela ne vous rappelle pas le film « La Matrice »?).
Est-ce que cela vous semble la définition d’une vie bien remplie? Passer votre vie entière à flotter dans une cuve ne semble pas utopique du tout, c’est au contraire une sorte d’enfer. Simplement être heureux en soi ne suffit pas.
La théorie des dix commandements
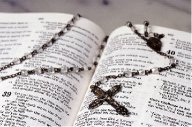 Certaines personnes prétendent que les dix Commandements, ou décalogue, constitue la somme totale de leur morale, un code autonome qui ne requiert aucun fondement théorique supplémentaire. La majorité toutefois croient que les Dix Commandements ne sont que des lignes directrices qui nous aident à remplir un large éventail moral. Est-ce une théorie réaliste?
Certaines personnes prétendent que les dix Commandements, ou décalogue, constitue la somme totale de leur morale, un code autonome qui ne requiert aucun fondement théorique supplémentaire. La majorité toutefois croient que les Dix Commandements ne sont que des lignes directrices qui nous aident à remplir un large éventail moral. Est-ce une théorie réaliste?
La première chose à noter est que la théorie des Dix Commandements (TDC) est un type de théorie religieuse de la moralité appelée la théorie du commandement divin (TCD). C’est la croyance selon laquelle une action est juste si les commandements de Dieu l’exigent. En d’autres termes, certaines actions sont bonnes ou mauvaises uniquement parce que Dieu dit qu’elles le sont, car il est l’auteur de morale. On entend souvent dire par les croyants et également des laïques (comme Jean-Paul Sartre et Dostoïevski) que si Dieu n’existe pas, tout est permis.
La TDC est une version légaliste de la théorie du commandement divin, selon lequel les commandements de Dieu sont énoncés dans des règles clairement définies dans les écritures sacrées ou par des exemples constatés dans la nature. Une autre version de la TDC soutient que les commandements de Dieu ne sont pas exprimés par un ensemble de règles immuables, mais par la dynamique de chaque situation morale. L’éthique chrétienne, même si elle peut prendre plusieurs formes, est généralement interprétée comme un type de commandement divin dans lequel les commandements sont ceux des enseignements du Christ, en particulier l’injonction «aime ton prochain. »
Maintenant, si la TCD est sans fondement, il en est ainsi de la théorie des Dix Commandements et cela soulève certains problèmes. Le premier et non le moindre est qu’elle n’est pas compatible avec notre expérience de la vie morale. La question se pose alors, est-ce qu’une action est bonne (ou mauvaise) parce que Dieu le dit ou Dieu le dit parce qu’une action est au préalable bonne (ou mauvaise)? Si la TCD est correcte, alors si Dieu le dit ça passe. S’il dit que torturer des enfants innocents est bien, alors c’est bien. S’il dit que le viol et le meurtre de vos voisins est juste, alors il a raison. Mais cette notion de la morale est absurde. Notre expérience nous suggère que certaines actions sont mauvaises et il est invraisemblable que de mauvaises actions puissent devenir justes, uniquement parce que Dieu l’ordonne. Il est à noter que beaucoup de penseurs religieux rejettent la TCD précisément pour ces motifs.
Un adepte de la TCD pourrait répondre à cet argument en disant quelque chose comme: Dieu ne pourrait jamais exiger de nous de mauvais actes parce que Dieu est infiniment bon. Mais prétendre cela revient à faire un argument circulaire et cela ne renforce pas, au contraire la théorie de commandement divin. La théorie est censée nous indiquer ce qu’est la moralité, ou ce qui fait une bonne action. Mais si la bonté est une propriété définissant Dieu, alors Dieu ne peut pas être utilisé pour définir la bonté. Une telle tactique aboutirait à une définition vide de sens: Les bonnes actions sont celles commandées par un Dieu bon. Contrairement aux apparences, cette affirmation ne nous apprend rien sur ce qui fait qu’une action est bonne.
Certains croyants pourraient soutenir que même si la TCD est sans fondement, nous devrions quand même faire ce que Dieu ordonne, car il récompense l’obéissance et punit la désobéissance. Mais ce point de vue s’effondre rapidement et on se retrouve face à une variante de l’égoïsme éthique, insistant sur le fait que nous devons faire ce qui est dans notre propre intérêt, à savoir, chercher la récompense et éviter la punition. Mais comme nous l’avons vu, une théorie de la morale construite uniquement sur l’intérêt personnel n’est pas une théorie très valable.
Un autre problème sérieux avec le TDC est qu’elle entre en conflit avec nos jugements moraux raisonnés. Comme nous l’avons noté, les commandements sont absolutistes, ils ne tolèrent aucunes exceptions. La loi c’est la loi, dit la TDC et l’impact que celle-ci peut avoir sur le bien-être d’une personne ne doit pas être pris en compte. Supposons qu’un terroriste vole un dispositif nucléaire et menace de faire sauter une grande ville, tuant des millions de personnes. Le seul moyen d’arrêter cette catastrophe est pour vous de briser le commandement contre le meurtre et d’assassiner le terroriste. Selon la TDC, tuer le terroriste, même comme un moyen de sauver une ville entière – serait mal parce que les Dix Commandements interdisent de telles actions. Mais ce point de vue semble difficilement acceptable.
Mais ce n’est pas tout. La théorie des Dix Commandements comme tous les codes moraux par ailleurs est inapplicable. Les codes moraux sont en effet des ensembles de règles qui sont intrinsèquement vagues. Elles ne peuvent donc pas offrir beaucoup d’aide aux personnes qui ont besoin de réponses précises sur des cas spécifiques. Prenons par exemple le commandement «honore ton père et ta mère. » Est-ce que cela signifie que les enfants doivent honorer leurs parents, même si leurs parents abusent d’eux? Que faire si le père ou la mère sont des psychopathes criminels? La règle s’applique-t-elle à un beau-père? Aux mères adoptives? Aux parents des bébés-éprouvette? Le moins que l’on puisse dire est que tout ceci manque de clarté.
En outre, les théories morales plausibles sont censées nous aider à résoudre des dilemmes moraux, mais la TDC (comme d’autres codes moraux) en est incapable. Lorsque deux commandements ou règles sont en conflit, il n’y a aucun moyen de résoudre le conflit sans faire appel à une théorie morale hors de la portée des Dix Commandements .On nous ordonne de ne pas tuer et de ne pas voler, mais que faire si la seule façon d’éviter de tuer quelqu’un est de voler? Ou si la seule façon d’éviter de tuer une centaine de personnes est d’en tuer un seul? On nous dit de ne pas porter de faux témoignage, mais que faire si en racontant un mensonge, nous pouvons sauver la vie d’un millier de personnes innocentes? Les Dix Commandements donnent lieu à de nombreux conflits de ce genre, mais ne peut pas les résoudre. Ces lacunes font la TDC une piètre théorie de la moralité.
L’éthique de Kant
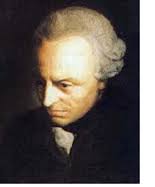 Emmanuel Kant (1724-1804) a proposé une théorie de la morale ne faisant pas appel à la religion et dont l’influence se fait sentir encore de nos jours. Kant rejette explicitement l’idée que la moralité puisse être fondée sur des propriétés naturelles telles le bonheur humain, le plaisir, le bien-être, ou la survie. Il soutient que ces propriétés ne sont pas nos meilleurs guides, car elles ne n’ont pas de valeur intrinsèque (elles ne sont pas bonnes en tant que tel). La seule chose qui est intrinsèquement précieuse est une «bonne volonté» c’est-à-dire la motivation de faire notre devoir parce que c’est la meilleure chose à faire et non par égard pour l’impact que nos actions peuvent avoir ou même à cause de sentiments comme la compassion ou l’amour. Pour Kant, les bonnes actions sont celles effectuées à partir d’un sens du devoir comme fin en soi.
Emmanuel Kant (1724-1804) a proposé une théorie de la morale ne faisant pas appel à la religion et dont l’influence se fait sentir encore de nos jours. Kant rejette explicitement l’idée que la moralité puisse être fondée sur des propriétés naturelles telles le bonheur humain, le plaisir, le bien-être, ou la survie. Il soutient que ces propriétés ne sont pas nos meilleurs guides, car elles ne n’ont pas de valeur intrinsèque (elles ne sont pas bonnes en tant que tel). La seule chose qui est intrinsèquement précieuse est une «bonne volonté» c’est-à-dire la motivation de faire notre devoir parce que c’est la meilleure chose à faire et non par égard pour l’impact que nos actions peuvent avoir ou même à cause de sentiments comme la compassion ou l’amour. Pour Kant, les bonnes actions sont celles effectuées à partir d’un sens du devoir comme fin en soi.
Kant prétend que nous apprenons à reconnaître notre devoir par la raison. Tous nos devoirs sont dérivés logiquement d’un principe unique, ce que Kant appelle l’impératif catégorique. (Impératif, parce qu’il nous ordonne de faire quelque chose et catégorique, car cette obligation doit être obéie en toutes circonstances.) Il soutient que nous savons ce principe a priori. C’est-à-dire indépendamment de notre expérience humaine, comme nous savons plusieurs vérités logiques, par exemple « tout ce qui a une forme à une taille». Il construit ainsi une théorie morale qui est à la fois formaliste et non religieuse.
Kant a produit deux formulations de l’impératif catégorique. Le premier dit:
« Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle »
C’est-à-dire, agir uniquement selon des principes moraux que vous pourriez rationnellement souhaiter devenir une loi morale applicable à tous. Selon Kant, chaque fois que vous effectuez une action, vous agissez implicitement, selon un principe moral. Pour déterminer si une action devrait être un devoir, vous devez vous demander ce qui arriverait si le principe en vertu duquel vous agissez devenait une loi universelle, que tout le monde appliquerais. Imaginez-vous un monde semblable? Est-il vraiment raisonnable de souhaiter voir que ce principe devienne universel? Si la réponse est oui, alors vous devez agir en conséquence. Si la réponse est non, alors le principe doit être écarté.
Supposons que vous avez volé une voiture, selon le principe de « je prends les possessions des autres chaque fois que j’en ai envie. » La question à se poser serait, est-ce que ce principe devrait être universel? Prenez note que si c’était le cas et que cela devienne une loi universellement appliquée, l’idée de propriété privée cesserait d’avoir un sens. Rien n’appartiendrait vraiment à personne. Ainsi, le principe même n’aurait aucun sens. Donc vous ne pourriez pas rationnellement désirer que ce principe devienne universel.
En appliquant l’impératif catégorique de cette manière, Kant propose plusieurs fonctions catégoriques, des devoirs qui ne souffrent aucune exception quelle que soit les circonstances. Il s’agit notamment de l’obligation de ne pas tuer des innocents, ne pas mentir et de ne pas briser ses promesses.
La seconde formulation kantienne de l’impératif catégorique est
« agis de façon à traiter l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne des autres, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen »
Ce fameux dicton semble capter quelque chose d’essentiel dans les théories morales, soit le respect de l’autre. Nous ne devrions pas traiter les personnes comme un simple moyen pour arriver à une fin, nous ne devons pas non plus les utiliser comme des outils. Nous devons plutôt les traiter comme une fin en eux-mêmes, comme ayant une valeur de plein droit. L’opinion de Kant est que les personnes sont intrinsèquement précieuses, car elles ont une conscience, sont rationnelless et libres de faire leurs propres choix. Il s’ensuit qu’il serait mal de voler de l’argent à quelqu’un parce que ce serait le traiter simplement comme un moyen de faire un gain financier. Il est mal de mentir aux gens parce que ce serait les manipuler afin de servir les intérêts d’une tierce personne. Il est mal de réduire une personne en esclavage et de les utiliser contre leur volonté pour le bénéfice de quelqu’un d’autre.
Cette notion de respect des personnes trouvent écho chez les humanistes. Certains pourraient même dire que l’idée que la valeur intrinsèque des humains est l’idée centrale de la pensée humaniste. Mais cette idée est également un principe fondamental de la morale chrétienne, pour laquelle chaque personne a une valeur infinie. Kant, cependant, a probablement fait davantage pour démontrer que le respect des personnes est essentiel à la morale et que ce principe peut reposer sur des bases solides.
La théorie de Kant a quelques avantages par rapport à l’utilitarisme. Le principal étant qu’il fixe des limites strictes sur ce qui peut être fait à autrui. Peu importe la somme de bonheur pouvant être acquise dans le monde, il y a certains actes qui ne devraient jamais être commis à l’encontre des personnes. Étant donné que les individus ont une valeur intrinsèque, ils ont des droits moraux et ces droits ne peuvent pas être ignorés sous prétextes de considérations utilitaires ou au nom du bien commun.
Mais la théorie de Kant n’est pas sans failles, car les devoirs dérivés de l’impératif catégorique ne tolèrent aucune exception. Comme dans la théorie des Dix Commandements, les devoirs moraux de Kant doivent être honorées coute que coute. Selon le système de Kant, vous ne devriez jamais mentir, pas même si un mensonge peut sauver des douzaines de vies. Vous ne devriez jamais tuer une personne innocente, même si une telle folie meurtrière pourrait éviter le décès d’un million d’autres personnes innocentes. Mais cette notion de devoirs catégoriques est problématique car il ne semble pas y avoir de telles obligations. Nous avons des devoirs, mais aucun ne semble être catégorique. Nous pouvons toujours imaginer des scénarios possibles, comme ceux ci-dessus ou honorer un devoir catégorique aurait des conséquences désastreuses. Dans la même veine, il semble y avoir des cas où il serait justifié d’utiliser des personnes comme un moyen d’obtenir un résultat. Croyez-vous qu’il serait moralement acceptable de mentir à quelqu’un, de l’utiliser comme un moyen, si cela signifie empêcher une troisième guerre mondiale?
La théorie de Kant ignore les conséquences des actions. Dans notre expérience de la morale, les effets de nos actes ont une influence sur nos jugements moraux. L’utilitarisme peut mettre trop d’emphase sur les conséquences, mais la déontologie kantienne ne leur donne aucun poids.
En tant que telle, la théorie de Kant est impraticable. Beaucoup de devoirs peuvent être dérivés de l’impératif catégorique et parfois ils entrent en conflit. Il est concevable, par exemple, que le fait de tenir une promesse puisse causer la mort d’une personne innocente. Il est concevable également que le fait de tenir votre promesse de visiter un ami à l’hôpital vous fasse ignorer les appels d’une autre personne gravement blessée, entraînant la mort de celle-ci. Une bonne théorie morale nous donnerait des conseils sur la façon de résoudre ces conflits, mais Kant demeure muet là-dessus. En fait, il semble avoir complètement ignoré que de tels conflits puissent se produire.
Le situasionnisme
Certaines personnes ont adopté la théorie de l’éthique de situation (ou situationnisme), qui affirme que les bonnes actions sont celles qui sont fondées sur l’amour de notre prochain. Tous les autres principes moraux et tous nos devoirs sont censés être issus de cette unique proposition.
Cette théorie peut avoir soit une formulation religieuse ou laïque. La version religieuse se résume dans la Bible, Matt. 22:37-40, qui nous ordonne «tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur» ainsi que «aime ton prochain comme toi-même. » Ici l’impératif de l’amour s’étend à Dieu, ainsi qu’aux humains. Ce type de théorie a aussi été appelé agapè (du mot grec pour amour) et a été très influent dans la tradition judéo-chrétienne. La version laïque omet bien sûr l’injonction d’aimer Dieu et insiste sur l’obligation d’aimer l’humanité, ce qui signifie que la version non-religieuse de la théorie de l’amour peut être qualifié de théorie humaniste de la moralité.
Une forme attrayante de cette théorie comporte un fort élément de situationnisme, l’idée que les jugements moraux ne peuvent être fondés sur des règles, mais sur la dynamique de chaque situation. L’éthique situationniste est le terme général pour désigner les théories morales fondées sur le situationnisme. C’est l’idée est que chaque situation est unique et indépendante de celles qui l’ont précédées et que pour chacune nous devons évaluer l’ensemble des faits et se demander quelle action est la meilleure possible dans les circonstances. Il n’y a aucun mandat légaliste, uniquement l’idéal d’amour et peut-être quelques règles de base.
Joseph Fletcher fut le promoteur le plus notable du situationnisme, qui affirme que l’amour est le seul bien universel à poursuivre. Sa théorie est intéressante pou r beaucoup parce qu’elle s’oppose au légalisme éthique, l’idée que la moralité est fondée sur l’adhésion à un ensemble de lois ou de règles. La théorie des dix commandements est une forme de légalisme éthique.
r beaucoup parce qu’elle s’oppose au légalisme éthique, l’idée que la moralité est fondée sur l’adhésion à un ensemble de lois ou de règles. La théorie des dix commandements est une forme de légalisme éthique.
Est-ce que l’éthique de situation est une bonne théorie? Le concept d’aimer son prochain semble certainement compatible avec nos jugements moraux. Certains éthiciens soutiennent que nous avons un devoir d’aimer les autres, surtout avec ceux qui ont agi avec amour envers nous. Mais quelles lignes directrices peuvent nous donner l’amour quand nous sommes confrontés à des dilemmes moraux, lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nous obligent à prendre des décisions difficiles? Fort peu, malheureusement.
La consigne d’aimer ne nous est pas d’un grand secours lorsqu’on se demande comment agir ou quelle règle suivre, ou quel chemin choisir. La question de l’euthanasie est un bon exemple de ce problème. Disons que votre mère est malade en phase terminale et souffre terriblement et vous implore de mettre fin à sa détresse. Puisque que vous l’aimez, vous voulez mettre fin à sa douleur, que sa maladie s’en aille, bref qu’elle vive. Mais comment l’éthique de situation peut vous aider dans un cas comme celui-ci? Devriez-vous faire ce que votre mère demande et l’aider à mettre fin à ses jours? Devriez-vous lui refuser cette demande? Que faire dans ce cas?
Ou imaginons que vous êtes un médecin et que vous devez décider qui, parmi une centaine de patients désespérés, va recevoir une transplantation d’organe qui va lui sauver la vie. Vous vous souciez de chaque patient, mais un seul peut obtenir la greffe. Les autres vont probablement mourir. À qui donnez-vous la transplantation, à la fillette de cinq ans, parce qu’elle est la plus jeune, à un homme d’âge moyen, car il est celui qui souffre le plus, à un homme dans la trentaine, car il est votre meilleur ami, ou à la science médicale, parce que la recherche pourrait un jour sauver de nombreuses vies?
L’amour devrait en effet faire partie de toute bonne théorie morale, mais une éthique basée uniquement sur l’amour est, en elle-même, impraticable et les théories situationnistes souffrent du même problème et il en est de même des théories qui remplacent l’amour comme guide idéal avec autre chose comme l’humanisme ou la vertu.
Une approche contemporaine: l’appel aux intuitions
Lorsque nous évaluons la véracité d’une théorie morale, à quelle preuves ou motifs nous référons nous pour juger de la justesse de notre expérience morale de tous les jours ou de nos jugements moraux raisonnés? Surement nous ne nous basons pas sur des faits empiriques ou une prémisse quelconque lorsque nous raisonnons. Nous faisons appel à ce que les philosophes appellent notre «intuition morale». En philosophie, «l’intuition» ne renvoie pas à l’instinct ou à une conviction profonde, mais à une connaissance rationnelle ou perçu qui n’est pas fondée sur une perception ou un argument. Nous savons intuitivement, par exemple, que 2 + 3 = 5 ou ce que signifient les concepts «proche» et «loin». Une intuition morale concerne des concepts moraux ou des prémisses.
Dans le domaine de l’éthique, le recours aux intuitions morales est très répandu et respectée. Dans ce module, nous avons jugé de la validité des théories morales selon des critères raisonnés incluant nos jugements moraux et notre expérience morale. Les philosophes font la même chose. Ils pensent que toute théorie morale valable doit tenir compte de nos intuitions morales, et que si une théorie morale est en conflit avec nos intuitions alors elle doit être suspecte à nos yeux. Ils savent que nos intuitions morales ne sont pas infaillibles, mais ils comprennent aussi que nos intuitions reposent généralement sur des preuves solides sauf preuves du contraire.
 Depuis deux siècles, les philosophes ont mis de l’avant plusieurs théories rationalistes qui dépendent explicitement de nos intuitions morales. Une des théories les plus influentes faisant appel à l’intuition est celle du philosophe d’Oxford W.D. Ross (1877-1971). Contrairement à Kant, Ross affirme que nous n’avons pas seulement un devoir (l’il’impératif catégorique) à partir duquel tous les autres sont dérivés, nous avons plusieurs devoirs distincts et séparées. Nous reconnaissons ces devoirs, dit-il, de la même manière que nous reconnaissons les vérités mathématiques ou logiques, à travers nos intuitions rationnelles. Nos intuitions, affirme-t-il, révèlent que nos devoirs vont de soi. Une proposition allant de soi est celle, que si nous la comprenons, sommes justifiés de croire qu’elle est vrai. Citons Ross:
Depuis deux siècles, les philosophes ont mis de l’avant plusieurs théories rationalistes qui dépendent explicitement de nos intuitions morales. Une des théories les plus influentes faisant appel à l’intuition est celle du philosophe d’Oxford W.D. Ross (1877-1971). Contrairement à Kant, Ross affirme que nous n’avons pas seulement un devoir (l’il’impératif catégorique) à partir duquel tous les autres sont dérivés, nous avons plusieurs devoirs distincts et séparées. Nous reconnaissons ces devoirs, dit-il, de la même manière que nous reconnaissons les vérités mathématiques ou logiques, à travers nos intuitions rationnelles. Nos intuitions, affirme-t-il, révèlent que nos devoirs vont de soi. Une proposition allant de soi est celle, que si nous la comprenons, sommes justifiés de croire qu’elle est vrai. Citons Ross:
« L’acte de remplir une promesse, ou d’effectuer une juste répartition du bien est juste prima facie (à prime abord), c’est une évidence, pas dans le sens où cela apparait évident depuis le début de notre vie, ou dès que nous somme témoin de la chose la première fois, mais dans le sens ou lorsque nous avons atteint suffisamment de maturité mentale et accordé une attention suffisante à cette proposition, cela devient évident, sans autre besoin de preuve, ou alors la preuve se suffit à elle-même. »
Comme nous l’avons vu dans le cas de la théorie des Dix Commandements, si nous avons plusieurs devoirs distincts, il va forcément y avoir des conflits entre eux. Ross tente de résoudre Le problème en établissant une sorte de hiérarchie des droits. Il fait une distinction entre deux types de tâches – prima facie et réelle .Les devoirs prima facie sont ceux que nous sommes obligé d’exécuter en toute situation, sauf en cas de circonstances spéciales qui justifient une exception à la règle. Les circonstances particulières sont les cas dans lesquels les devoirs prima facie entrent en conflits. Par exemple, « Ne pas voler» est un devoir prima facie , il en est de même pour «Ne pas faire de mal à autrui ». Ces droits seraient en conflit si, par exemple, la seule façon pour vous de ne pas faire de mal gravement à plusieurs personnes serait de voler quelque chose. Un devoir réel est celui que nous devrions effectuer dans un cas particulier, une fois que nous avons tenu compte des contradictions dans nos devoirs prima facie c’est à dire, une fois que nous avons décidé quel devoir est le plus important à respecter dans cette situation. Un devoir réel devient le devoir que nous choisissons en bout de ligne.
Les devoirs prima facie de Ross comprennent
- Le devoir de fidélité (remplir vos promesses, honorer vos contrats, dire la vérité)
- Le devoir de justice (traitement équitable des personnes)
- Le devoir de bienfaisance (venir en aide aux autres)
- Le devoir de reconnaissance (récompenser les actes de bonté chez les autres)
La théorie de Ross semble bien s’accorder avec nos intuitions morales à propos des devoirs, y compris notre compréhension du fait que certains devoirs doivent avoir préséance sur certaines considérations à propos des conséquences de nos actions ou envers le bien commun. Mais telle qu’elle est, sa théorie est impraticable, car elle nous fournit peu d’indices sur la manière de résoudre les conflits entre les devoirs. La distinction entre les devoirs prima facie et réels est un bon point en sa faveur, mais ce n’est malheureusement pas suffisant pour nous montrer la meilleure façon de classer les devoirs par ordre d’importance.
Beaucoup de philosophes trouvent que l’aspect le plus discutable de la théorie de Ross n’est pas sa maniabilité, mais sa notion des intuitions morales. Les critiques de Ross lui reprochent principalement deux choses (1) prétendre que nous avons une faculté mystérieuse de l’esprit qui nous suscite des intuitions morales et (2) que nos intuitions morales nous permettent une « connaissance certaine » des principes moraux. À la lumière de ce qui est connu sur l’épistémologie et la philosophie de l’esprit, ces deux hypothèses semblent douteuses.
Les partisans modernes de « l’intuitionnisme » s’accordent pour dire que (1) et (2) sont discutables et maintiennent qu’il existe des formes beaucoup plus plausible de l’intuition morale. Ils soutiennent que nos intuitions morales ne sont pas plus mystérieuses ou invraisemblables que d’autres types d’intuitions morales que nous rencontrons tous les jours. Une approche plus crédible des intuitions morales est qu’elles peuvent aller de soi sans être infaillible. Qu’elles peuvent éviter l’arbitraire, car elles impliquent une réflexion et doivent rencontrer les exigences d’une théorie morale. De plus elles ne sont pas mystérieuses car elles interviennent de la même manière que d’autres types d’intuitions rationnelles à partir d’une compréhension des concepts et propriétés en jeu.
Le philosophe Robert Audi, un partisan avoué de l’approche intuitionniste contemporaine, explique les revendications plus modestes de cette approche moderne:
« Dans sa forme actuelle, je propose que l’intuitionniste éthique est, dans ses grandes lignes, l’idée que nous sommes justifiés d’adhérer à des jugements et des principes moraux intuitifs, et cela à la lumière d’une réflexion appropriée sur le contenu de ces derniers. La plupart des versions de l’intuitionnisme approuvent une pluralité de principes moraux (bien que Moore est reconnu pour tenir au principe utilitariste des bonnes actions), et la plupart des versions sont plutôt rationalistes, estimant qu’il existe certains principes moraux a priori. Mais un intuitionniste pourrait aussi être un empiriste, prêtant à l’intuition la capacité de nous fournir un terrain d’expérience sur les jugements moraux ou les principes. Les intuitionnistes pensent généralement que la connaissance morale ainsi que la justification morale peuvent être intuitive, mais pour la plupart ne sont pas chaud à l’idée que cette justification ou connaissance soit imprescriptible et ont alors tendance à nier qu’elle le soit.»
Tout en plaidant pour une réelle compréhension des intuitions morales, certains philosophes ont essayé d’améliorer les théories de Ross en proposant des moyens de résoudre les conflits entre les devoirs. Une suggestion est d’utiliser l’l’impératif catégorique de Kant comme formule pour jauger des devoirs concurrents. Par exemple, si le devoir de dire la vérité est en conflit avec le devoir de ne pas nuire à autrui (par exemple si un psychopathe vous demande ou est votre ami car il a l’intention de le tuer), le facteur décisif pourrait être que votre choix devrait raisonnablement être adopté par tous
Une autre proposition est d’utiliser nos intuitions morales, en particulier nos devoirs, afin de favoriser des conséquences désirables, tel respecter les personnes et se préoccuper de ceux qui prennent soin de nous, comme critères pour juger de la justesse de nos actions. Les scientifiques utilisent certains critères pour juger de la pertinence des théories scientifiques (tels que la simplicité d’une théorie ou combien de phénomènes elle explique). De même, nous pourrions utiliser nos responsabilités fondamentales en tant que normes pour juger de nos actions. Cette vision suppose à juste titre que ces critères ne peuvent pas être classés par ordre d’importance. Mais ils peuvent rendre nos choix objectifs car ces critères ne dépendent pas de l’état mental de quiconque.
L’intuitionnisme a plusieurs avantages sur les autres théories que nous avons examinées. Principalement à cause des pistes de solutions qu’elle offre, permettant de résoudre les conflits entre différents devoirs. Il s’accorde plutôt bien avec nos jugements moraux raisonnés et notre expérience morale et accorde l’attention voulue aux intuitions morales. Ils ne sont pas entravés par un aveuglement utilitariste de nos droits ou des droits des individus. Ils évitent aussi les problèmes de type kantien des devoirs catégoriques. Et ils peuvent s’accommoder des considérations sur les conséquences des actes.
Également notez que les théories intuitionnistes ne nécessitent aucun appel au religieux. Nos intuitions morales semblent n’avoir nul besoin d’une référence à un être suprême. Et parce que l’intuitionnisme, par définition, est réglementé par nos jugements moraux raisonnés et notre expérience morale, il peut facilement être adopté par les humanistes.
Résumé
Nous avons vu que peu importe la forme que peut prendre une théorie morale, elle ne peut être complètement absolutiste. Les conséquences de nos actions sont un élément important lorsque vient le temps de faire des jugements moraux. Mais les conséquences de nos actions sont loin d’être le seul élément à prendre en considérations, car certaines actions ne devraient jamais être effectuées même si elles pourraient aboutir à un plus grand bonheur. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que toute théorie morale adéquate doit être un mélange de facteurs conséquentialistes et formalistes.
De plus, nous avons appris que toute bonne théorie morale ne doit pas entrer en conflit avec notre bon sens commun en ce qui concerne les droits, la justice, ou nos devoirs. Et ils doivent avoir un niveau de sophistication suffisamment élevé pour de ne pas postuler que l’amour et le bonheur sont tout ce qu’une bonne vie exige.
Mais quelle conclusion pouvons-nous tirer de ces comparaisons entre les théories morales religieuses et laïques? Au départ on peut affirmer que les éléments apportés par la religion et le théisme dans les théories morales ne sont tous simplement pas suffisant en soi pour rendre ces théories méritoires. Certaines théories hautement suspectes sont en effet plombées d’éléments religieux ou faisant appel au surnaturel. De même, l’aspect séculier des théories morales à lui seul n’est pas suffisant pour rendre celles-ci plausibles. Certaines théories laïques en fait, échouent lamentablement. Enfin, certaines théories peuvent être laïques tout en foulant au pied l’humanisme. Elles ont beau larguer la religion, cela ne les empêche pas d’afficher un manque de respect pour le bien-être, les droits et la dignité des êtres humains.
